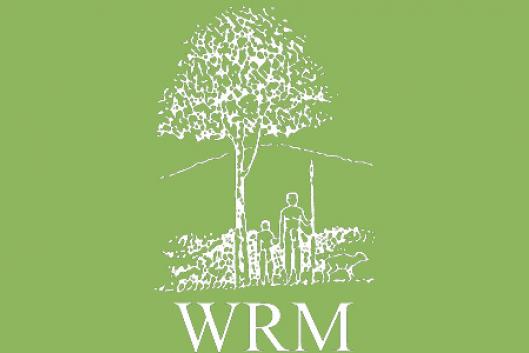Les forêts naturelles ne sont pas les seuls paysages que les plantations d’arbres sont en train d’envahir. Les prairies indigènes de l’Afrique du Sud, riches en diversité biologique, sont maintenant remplacées à toute vitesse par la monoculture d’espèces très consommatrices d’eau, comme l’eucalyptus et le pin, utilisées pour l’exportation de pâte à papier.
Nous sommes à God’s Window, un point d’observation très connu situé au bord de l’escarpement de Drakensberg, dans le Nord-Est du pays. À nos pieds, un ravin de 700 mètres de profondeur plonge dans une mer de feuillage sombre. Des kilomètres et des kilomètres de forêt s’étendent de là jusqu’au parc national Kruger, sur la frontière du Mozambique.
« Le problème est que ce ne sont pas des forêts. Ce sont des plantations géantes d’origine étrangère », explique Philip Owen, coordinateur de Geasphere, une organisation écologiste financée par la Société suédoise pour la conservation de la nature.
Quand les premiers Européens sont arrivés ici dans les plaines basses, le paysage que nous voyons était dominé par la prairie et la savane, avec des forêts indigènes seulement dans les vallées des fleuves. Aujourd’hui il ne reste que des vestiges de cet écosystème originel.
« Beaucoup de personnes voient les prairies comme des paysages uniformes, alors qu’elles contiennent en fait une énorme diversité : 82 espèces de plantes par kilomètre carré et une profusion d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères. Une seule espèce végétale sur six est une graminée ; les autres sont surtout des vivaces résistantes. Certaines peuvent survivre des milliers d’années au même endroit. »
Plus de soixante pour cent des prairies d’Afrique du Sud ont disparu et ne pourront jamais être restaurées. Ici, dans la province de Mpumalanga, le processus se poursuit depuis des générations, depuis si longtemps que beaucoup considèrent aujourd’hui les eucalyptus australiens et les pins mexicains comme des espèces indigènes. Les premiers ont été plantés il y a un siècle pour produire du bois pour l’industrie minière.
Ces plantations couvrent à présent un million et demi d’hectares, dont 600 000 à Mpumalanga. La route qui va de God’s Windows à la capitale de la province, Nelspruit, ressemble à celles qui traversent la forêt dans le Nord de la Suède mais les rangées d’arbres parfaitement alignés et le sol grisâtre et épuisé racontent une histoire différente.
Le sol de cette région manque des microorganismes nécessaires à la décomposition des feuilles d’eucalyptus et de pin. La voûte de feuillage empêche le passage de la lumière, tandis que les racines pénètrent jusqu’à la nappe d’eau souterraine.
« Ces pins absorbent 25 litres d’eau par jour, et les eucalyptus peuvent en consommer jusqu’à 600, beaucoup plus que n’importe quelle espèce d’arbre indigène », dit Philip Owen.
Philip a lancé Geasphere en 1999, après un grand sommet concernant la crise de l’eau en Afrique du Sud. À beaucoup d’égards, les dégâts ne vont pas se poursuivre à Mpumalanga. Les plantations sont là mais leur expansion est limitée par le manque de terres disponibles. Néanmoins, les efforts de Geasphere vont bien au-delà de cette région. L’organisation diffuse des informations et exerce de l’influence dans les pays voisins, le Mozambique et le Swaziland, où les espèces exotiques avancent rapidement. Dans le tout petit Swaziland elles couvrent aujourd’hui dix pour cent du territoire.
« Le développement est crucial pour le Sud de l’Afrique mais la multiplication des plantations d’arbres n’est pas le modèle à suivre. Elles ne créent pas beaucoup d’emplois ni de revenus et elles ont de fortes répercussions sur l’accès à l’eau, sur la diversité biologique et sur les structures sociales. »
Philip trouve particulièrement contrariant que plus de 80 % des plantations d’arbres sud-africaines aient été certifiées par le FSC en tant que forêts gérées de façon responsable. Cela donne aux consommateurs du Nord une image trompeuse de la réalité. Or, c’est dans les pays industrialisés que la plupart du bois est consommé.
À l’ouest de Nelspruit se trouve l’usine papetière la plus grande de l’Afrique du Sud, Ngodwana. En arrivant dans la vallée, l’air est lourd de l’odeur de sulfate. Une brume jaunâtre nous entoure bien avant que les cheminées ne se dressent à l’horizon.
« L’écoulement de l’eau est considéré comme suffisant pour diluer les déchets et les ramener à un niveau ‘acceptable’, mais on oublie que les périodes de sécheresse sont en train de s’allonger et que cela fait diminuer le débit. »
L’usine produit 500 000 tonnes de pâte de papier par an, surtout pour l’exportation. La demande est forte et le propriétaire de l’usine, le groupe multinational Sappi, prévoit d’accroître la production de 70 %. La matière première additionnelle sera obtenue en partie en remplaçant les pins par des eucalyptus, qui croissent plus vite mais consomment davantage d’eau. L’augmentation de la production ne se traduira pas par une augmentation du nombre d’emplois.
Tandis que l’Afrique du Sud, la « Nation Arc-en-ciel », lutte pour l’égalité des blancs et des noirs, la situation en matière de travail semble être restée figée dans le temps. Les travailleurs noirs vivent dans la vallée, où nous avons visité Bhamgee, un bidonville chaotique où il n’y a même pas de rues ni d’installations élémentaires. Le petit village d’autrefois s’est élargi pour accueillir les prostituées attirées par le nombre d’ouvriers de l’usine et de routiers. La prostitution, le VIH et le SIDA y sont devenus endémiques.
Plus haut, sur les pentes des montagnes, les employés de niveau plus haut vivent dans des villages clôturés. En tant que visiteurs blancs et bien que notre visite n’ait rien d’officiel, nous passons sans problème devant le garde de sécurité armé, qui est noir. On ne voit que des employés blancs à l’extérieur des villas luxueuses devant lesquelles il y a souvent deux voitures garées. Des pelouses vertes séparent les maisons, et l’ensemble fait penser à un quartier riche en Suède.
Philip Owen a grandi pendant l’apartheid. Il décrit ses années d’école à Nelspruit comme une sorte de lavage de cerveau, à l’opposé de son expérience à la maison où les limites raciales étaient moins démarquées. À Geasphere, les noirs et les blancs travaillent côte à côte. Trente kilomètres plus loin, chez Philip, j’ai rencontré Thelma Nkosi et December Ndlovu qui travaillent tous deux pour l’organisation.
« Les plantations ont beaucoup d’effets négatifs sur la société, et le manque d’eau touche surtout les femmes, qui sont forcées d’aller bien plus loin pour trouver de l’eau et du bois », explique Thelma.
La vie est devenue moins sûre. Il est dangereux de passer par les plantations où se cachent souvent des violeurs et des criminels. Les arbres provoquent l’érosion, l’épuisement du sol et la diminution des aliments disponibles. Les répercussions sociales sont aussi évidentes.
« Notre identité est menacée lorsque les plantations envahissent les sites rituels. Les cimetières des ancêtres deviennent inaccessibles, les arbres qui ont des fonctions traditionnelles disparaissent et les cérémonies d’initiation, parmi d’autres, ne peuvent plus y avoir lieu », explique December.
Les expériences à Mpumalanga sont importantes pour des pays moins riches, comme le Mozambique et l’Angola.
« Ils réclament des investissements parce qu’il est facile de croire à la propagande des entreprises forestières. Les inconvénients ne se voient que plus tard », dit Thelma.
L’activisme environnemental de Philip s’est déclenché lorsqu’on a fait des plantations d’arbres sur la montagne qui domine Sudwalaskraal. Philip vit là, dans la ferme familiale que son grand-père a achetée en 1960 et que des membres de la famille se partagent aujourd’hui. Le flanc de la montagne est couvert de forêt tropicale indigène ; les ravins sont criblés de grottes de calcaire vieilles de trois milliards d’années que des humains (homo habilis) habitaient il y a 1,8 million d’années. Les grottes de Sudwala sont des merveilles géologiques et historiques qui attirent chaque année une foule de visiteurs.
Les effets des plantations sont évidents. Les parois des grottes ne gouttent plus, on y apporte de l’eau par des tuyaux. Les sources qui alimentaient la forêt n’ont plus d’eau pendant la saison sèche.
Nous marchons jusqu’à la prairie qui reste au sommet de la montagne. Le soleil couchant nous donne un aperçu de la beauté saisissante du paysage originel. La femme de Philip, Elsmarie, nous montre des herbes rares, des graminées et des tanières de serpents, mais aussi de petits pins qui réussissent toujours à s’y faufiler depuis la plantation qui se dresse comme une muraille sombre de l’autre côté de la montagne.
« Il faut constamment lutter pour éviter la propagation d’espèces non indigènes. En Afrique du Sud, les arbres qui ont poussé sans contrôle couvrent une superficie aussi grande que celle des plantations. On peut abattre les pins mais, pour enlever les eucalyptus, il faut empoisonner les racines », explique Philip.
Des étendues de prairie noircie témoignent d’incendies récents. Il faut que cela arrive régulièrement pour maintenir la diversité biologique, mais quand le feu trouve une plantation d’arbres les effets peuvent être dévastateurs.
« Ces derniers temps nous avons eu de graves incendies de forêt qui ont tué de nombreuses personnes. Autrefois, les arbres indigènes accumulaient de l’humidité et jouaient le rôle de coupe-feu, mais à présent tout est trop sec. La chaleur est si forte que la surface du sol est cuite en une croûte dure. L’eau de pluie ruisselle et s’évapore au lieu de pénétrer dans la terre. »
Le lendemain nous avons suivi December dans sa ville natale, Bushbuck Ridge. Le contraste avec les fermes blanches est saisissant. Ici, un million de personnes vivent dans un bidonville tentaculaire, souvent sans eau ni électricité. December nourrit sa famille en lavant des voitures dans un hangar à côté de sa maison.
Plus de 80 pour cent des Sud-africains utilisent les médecines traditionnelles plutôt que les techniques occidentales. À mesure que les prairies disparaissent les praticiens ont de plus en plus de mal à trouver leurs matières premières. December nous mène chez Hilda Calinah Manyike, une nganga ou guérisseuse herboriste, titulaire d’un permis officiel pour cueillir des herbes médicinales dans les parcs nationaux et les réserves. Sa cabane contient une petite pharmacie.
« Avant, il était plus facile de trouver toutes les herbes qu’il me fallait. À présent je dois parcourir de longues distances pour les trouver et quelques-unes n’y sont plus. »
Hilda ne peut plus traiter certaines affections, comme l’asthme, et elle est obligée d’adresser ses patients à un médecin occidental, quand ils peuvent le payer.
À l’est, Bushbuck Ridge est limité par le parc national Kruger. Dans ce parc clôturé vivent les mêmes grands animaux qui erraient autrefois à travers les plaines basses et les savanes environnantes.
En franchissant l’entrée du parc nous devons freiner pour laisser passer un troupeau d’éléphants. Des gnous, des girafes, des zèbres et divers antilopes vagabondent des deux côtés du chemin. Nous y voyons aussi des babouins que les entreprises forestières ont exterminés dans les plantations.
Nous passons la nuit dans le parc. Dans le noir, j’entends les éléphants qui se déplacent pesamment comme d’énormes machines. À l’aube, un lion rugit.
« La diversité biologique de ces prairies a soutenu la vie humaine pendant des millénaires. Tout a été entièrement transformé au cours des cents dernières années », dit Philip, qui souhaite voir le monde se réveiller.
« Des herbages comme la prairie nord-américaine, la puszta hongroise et la steppe russe sont les types de végétation les plus menacés de tous. Quatre-vingts pour cent d’entre eux ont déjà disparu et ne peuvent pas être restaurés. »
Tiré de « Sveriges Natur », magazine de la Société suédoise pour la conservation de la nature.