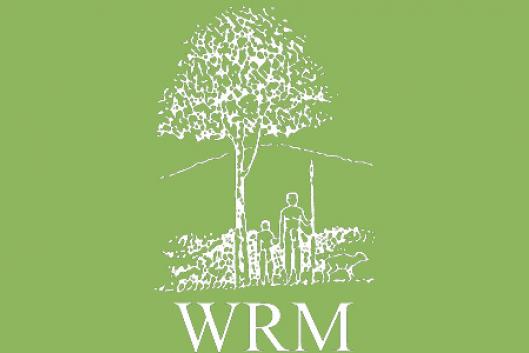Le Sud du Cameroun est rouge et vert. Vert comme la forêt du bassin du Congo, qui respire et pulse, offrant à ses habitants les ressources biotiques nécessaires à leur subsistance ; rouge comme les routes de poussière par lesquelles filent les camions qui transportent le corps des géants de la forêt pour être transformés en meubles, parquets, portes, etc. Les veines ouvertes du Cameroun laissent s’éprendre sa substance vitale jusque dans le port de Douala où le vampire du Nord vient s’abreuver…
De la forêt nous parviennent des voix de femmes. Dans le Sud-Est du Cameroun, des femmes s’organisent pour améliorer leurs conditions de vie et préserver un arbre mythique : le moabi (Baillonella toxisperma). Ce géant de la forêt du bassin du Congo est exploité de manière industrielle à un rythme qu’il est difficile de déterminer, mais qui affecte les populations locales, en particulier les femmes.
Pour les populations du Sud Cameroun, le moabi revêt une importance considérable. « Arbre sacré » : traditionnellement, les ancêtres décédés étaient assis au pied du tronc ou dans un trou du tronc ; ensuite, le moabi incarnait la puissance du défunt. « Arbre pharmacie » : son écorce, ses feuilles et ses racines servent à la préparation de plus de cinquante médicaments traditionnels, dont les traitements pour les règles douloureuses, les infections vaginales et les soins après l’accouchement. « Arbre nourricier » : ses fruits sont consommés – ce qui limite le travail domestique des femmes lors de la fructification – et les graines produisent une huile de qualité dont les femmes ont le contrôle de la collecte jusqu’à la commercialisation, ce qui représente l’une de leurs principales sources de revenu dans les régions productrices.
Au Cameroun, l’exploitation industrielle de la forêt a débuté à l’aube du 20ème siècle, lors de la colonisation allemande, dans la région littorale, puis elle s’est étendue dans le pays au rythme de la construction des voies ferrées. Ainsi, bien que certains exploitants ne voient pas d’explication à la diminution des moabis, on peut observer que la distribution de l’espèce est inversement corrélée à la présence historique des exploitants forestiers. En effet, le commerce du moabi s’avère lucratif, du fait de son prix élevé sur le marché international et de ses qualités en menuiserie. Il s’agit d’un bien de luxe qui agrémente l’intérieur des yachts ou des villas sous la forme de parquets, de fenêtres, de boiseries, etc. Le Théâtre des Champs Elysée à Paris a choisi de tapisser son sol d’un parquet de moabi…
Le commerce international du bois au Cameroun est exclusivement détenu par des firmes étrangères – principalement françaises, italiennes, libanaises et depuis peu chinoises. Cependant, le marché du moabi reste très franco-français avec, entre 2000 et 2005 (selon les statistiques officielles), 45% du volume de moabi produit par des exploitants français et 71% de la production vendue en France (24% en Belgique). Ainsi, le commerce du moabi s’inscrit admirablement dans les relations commerciales qui lient le Cameroun avec l’ancienne métropole.
Depuis les années 80, de nombreux villages sont en conflit avec les compagnies d’exploitation forestière autour de la réserve du Dja, une région riche en moabis. Les villageois ont envoyés de nombreuses lettres aux autorités compétentes pour revendiquer leurs droits d’usage sur l’espace forestier et demander la préservation des moabis. Ils ont entrepris d’organiser des discussions avec les exploitants, tenté de marquer les moabis pour signaler leurs droits d’usage et bloqué des engins jusqu’à ce que l’armée soit envoyée, mais aucune de ces mesures n’a réellement abouti. A Bedoumo, la grève pour bloquer la route des exploitants a été réprimée par l’armée dans la violence. Les villageois ont été forcés de ramasser à mains nues les braises des feux qu’ils avaient allumés sur la route pour supporter la fraîcheur de la nuit; ils ont été battus et torturés et, de ce fait, des femmes enceintes ont perdu leur bébé. Ces conflits mobilisent toute la communauté, bien que dans la plupart des cas les hommes soient mis en avant car ils sont supposés assurer le lien avec les autorités, par la parole et par l’écriture.
Cependant, les deux conflits spécifiquement liés au moabi qui ont opposé physiquement les villageois aux exploitants ont été pour l’un impulsé par des femmes et pour l’autre mené par des femmes. A Bapilé, FIPCAM, une entreprise italienne, a ouvert une route (pendant une journée de festivité lors de laquelle les villageois s’étaient rendu dans un village voisin) sur l’espace réservé pour la forêt communautaire, détruisant un cimetière. Le lendemain, dès qu’elles ont entendu le bruit des exploitants et découvrant des moabis en fleurs abattus, cinq femmes du village sont parties en forêt pour tenter de dissuader les ouvriers de continuer leur besogne – sans succès. Les jours suivants, toute la communauté s’est mobilisée pour bloquer la route et les engins, il s’en est suivi un mois de luttes et de grèves. Ceci a finalement abouti à la protection de quelques arbres restants et à la reconnaissance du tort causé (300 moabis abattus) qui n’est aujourd’hui toujours pas réparé.
Dans le village de Zieng-Ognoul, Pallisco, un exploitant français, a ouvert une route dans l’espace réservé à la forêt communautaire du village. Lorsque les villageois entendirent le bruit des engins, Mme Koko Sol entreprit de partir en forêt avec plusieurs personnes du village, principalement des femmes, et menaça d’incendier les engins de la compagnie si les ouvriers n’arrêtaient pas leur travail. Cette action a permis de repousser les exploitants et de préserver un bon nombre de moabis ; malheureusement 11 avaient déjà été coupés.
Dans certains cas, les conflits surviennent également entre les hommes et les femmes des villages. Premièrement, car les hommes sont employés dans les compagnies et répertorient les essences exploitables. Deuxièmement, car certains hommes vendent des moabis de leurs champs à des scieurs illégaux. Une femmes d’Ebimimbang soulignent que « le tort revient aux hommes car c’est eux qui sont en contact avec l’exploitant et qui connaissent l’importance qu’il [le moabi] a pour les femmes ».
La raréfaction des moabis pèse donc particulièrement sur les femmes qui doivent trouver des alternatives alimentaires, voient diminuer leurs revenus, manquent de matériels pour les soins et pour les traitements spécifiques des maladies génitales féminines. Ce phénomène vient s’ajouter à celui de la domination masculine qu’elles subissent dans leurs sociétés. Au vu de cette situation, Mme Rufine Adjowa a décidé de créer une ONG (le CADEFE) ayant pour objectif d’améliorer les conditions de vie des femmes en préservant le moabi. Il s’agit de réunir les villageoises en petits groupes, voire en coopératives, afin de développer la vente de l’huile de moabi. Ceci permet d’extraire des revenus substantiels pour les paysannes afin de payer la scolarité des enfants ainsi que des soins médicaux ou de s’acheter le pétrole et le savon dont elles ont besoin, sans devoir demander l’argent à leur mari.
De par leur marginalisation, toutes ces femmes s’affirment comme un groupe social susceptible d’impulser des changements dans les rapports de force et de proposer des solutions effectives pour une gestion durable et équitable des écosystèmes forestiers.
Par Sandra Veuthey, basé sur les observations de terrain de l’auteure.
sandra.veuthey@campus.uab.cat