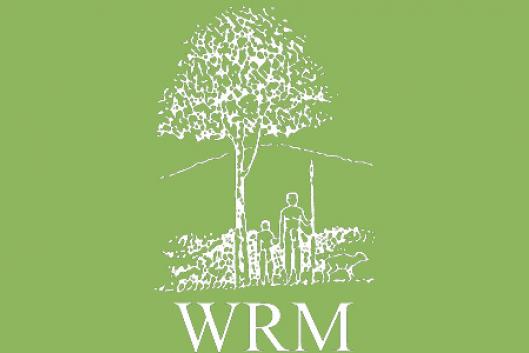Plusieurs jours déjà ont passé depuis la Conférence Mondiale des Peuples sur le Changement Climatique et les Droits de la Mère-Terre, convoquée par le président bolivien Evo Morales. Cependant, en ces époques d’information rapide et jetable, nous devons faire un effort pour que la signification cruciale de cette rencontre ne soit pas mise à la poubelle informative.
En son temps, la nouvelle eut une forte répercussion due surtout aux déclarations du président indigène sur le contenu en hormones féminines des poulets, lesquelles furent mal interprétées, voire peut-être pas très heureuses dans leur formulation.
Au-delà de cela, peu de medias furent à la hauteur d’une analyse sérieuse d’un évènement qui a quand même rassemblé plus de 30 000 personnes. Des représentants de communautés paysannes et indigènes, des groupes urbains, des écologistes, des fonctionnaires gouvernementaux, des intellectuels, des militants se sont réunis à Cochabamba – qui fut il y a 10 ans le théâtre principal de la guerre pour l’eau – et ont élaboré une plate-forme commune d’analyse du changement climatique.
Le changement climatique, cette menace qui plane sur toute l’humanité et qui, en général, se développe alors que nous sommes distraits. Le changement climatique, sur lequel pendant près de 20 ans les gouvernements – à travers une instance des Nations Unies, la Convention sur les changements climatiques – ont abondamment discuté, en s’éloignant chaque jour davantage des solutions réelles et en travaillant sur les conséquences du désastre, en observant comment nous nous en accommodons, comment nous nous y adaptons. Et en rendant ainsi le problème plus aigu.
C’est que, en cette époque où les intérêts des entreprises progressent grâce à leur appropriation de toutes les ressources que fournit la planète à leur soif de bénéfices (terre, eau, pétrole, minéraux, plantes, gènes, etc.…), le climat aussi est devenu un produit commercial. On a inventé de fausses solutions, des solutions « de marché ».
« Compensations » : celui qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, facteurs du changement climatique, paie pour qu’un autre, dans le Sud, n’en rejette pas, et « compense » ainsi ses émissions sans en réduire le volume.
Beaucoup d’argent pour certaines entreprises. Même un marché financier du carbone ! Et on repousse ainsi la responsabilité de stopper les émissions. Jusqu’à ce que, en décembre, dernier délai pour que les pays fixassent leurs engagements de réduction des émissions, le processus fut mis à nu, montrant que les puissants ne sont disposés à rien lâcher. Quelques rares pays, responsables historiques de la crise, tentèrent d’imposer une parodie d’accord qu’on nomma « Entente de Copenhague ». Il n’y apparaît aucune obligation, aucune mention de la responsabilité de ceux qui ont contaminé, aucun changement, mais il en ressort les pires perspectives, comme par exemple une augmentation de 4ºC de la température qui signifie une catastrophe.
Cochabamba a été l’alternative. La Bolivie, qui fut un des rares pays à dire NON à cette parodie d’accord, a convoqué la Conférence des Peuples. Et les peuples sont venus pour appeler les choses par leur nom, pour en parler avec des noms différents de ceux des documents officiels. Et c’est ainsi qu’on a parlé de la Mère-Terre et de ses droits, du « Vivre Bien », de la souveraineté alimentaire entendue comme le droit des peuples à contrôler leurs propres semences, leurs terres, leur eau et la production d’aliments en harmonie avec la Mère-Terre pour avoir accès à des aliments suffisants, variés et nutritifs, de la dette climatique produite par les pays considérés comme développés, de la justice restauratrice – c’est-à-dire, non seulement la compensation économique, mais aussi la restitution de leur intégrité aux personnes et aux communautés de vie sur la Terre –, d’ un tribunal qui aurait à juger des crimes commis contre le climat.
Et les peuples parlèrent de la racine du problème : les CAUSES du changement climatique.
L’Accord des Peuples (http://cmpcc.org/2010/04/24/acuerdo-de-los-pueblos/#more-1757), résultat d’un richissime travail participatif, intense, pluriel et original de 17 groupes thématiques, dit que la cause du changement climatique est la crise du système capitaliste : « Nous sommes confrontés à la crise terminale du modèle de civilisation patriarcale basé sur la soumission et la destruction des êtres humains et de la nature, qui se sont accélérées avec la révolution industrielle. Le système capitaliste nous a imposé une logique de concurrence, de progrès et de croissance illimitée. Ce régime de production et de consommation cherche le bénéfice sans limites, sépare l’homme de la nature, établit une logique de domination sur celle-ci, transforme tout en marchandise : l’eau, la terre, le génome humain, les cultures ancestrales, la biodiversité, la justice, l’éthique, les droits des peuples, la mort et la vie même ».
Face à cela, la proposition est : « la récupération, la revalorisation et le renforcement des connaissances, des savoirs et des pratiques ancestrales des Peuples Indigènes, fermement établis sur l’expérience et le propos de « Vivre Bien », en reconnaissant la Mère-Terre comme un être vivant, avec lequel nous avons une relation indivisible, complémentaire et spirituelle.
Le modèle que nous préconisons n’est pas fait de développement destructif et/ou illimité. Les pays ont besoin de produire des biens et des services pour satisfaire les nécessités fondamentales de leur population, mais en aucun cas ils ne peuvent poursuivre leur chemin vers ce développement dans lequel les pays les plus riches laissent une empreinte écologique 5 fois supérieure à ce que la planète est capable de supporter. Actuellement, on a déjà dépassé de 30 % la capacité de la planète à se régénérer. A ce rythme de surexploitation de notre Mère-Terre, nous aurions besoin de 2 planètes à l’horizon 2030.
Dans un système d’interdépendance dont nous, les êtres humains, sommes un des éléments, il n’est pas possible de reconnaître des droits seulement à la partie humaine du système sans déséquilibrer ce dernier tout entier. Pour garantir les droits de l’homme et rétablir l’harmonie avec la nature, il est nécessaire de reconnaître et d’appliquer effectivement les droits de la Mère-Terre ».
Ceux qui contaminent doivent assumer leur responsabilité. L’Accord des Peuples exige des pays développés qu’ils réduisent d’au-moins 50% leurs émissions, et qu’ils le fassent réellement, et non pas au moyen de systèmes frauduleux « qui déguisent la non-réduction des gaz à effet de serre », comme les marchés de carbone ou le récent mécanisme appelé REDD (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) qui tente d’incorporer les forêts dans le marché du carbone.
En matière de forêts, l’Accord des Peuples est catégorique quand il affirme que « la définition de forêt utilisée lors des négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques – qui inclut les plantations – est inacceptable.Les plantations en régime de monoculture ne sont pas des forêts. Par conséquent, nous exigeons une définition aux fins de négociation qui reconnaisse les forêts indigènes et la selve, et la diversité des écosystèmes de la Terre ».
L’agriculture à but lucratif, une agriculture industrielle faite par et pour les affairistes agricoles, a blessé à mort la Mère-Terre et ses enfants, parce qu’elle ne respecte pas le droit à l’alimentation, et qu’elle est une des principales causes du changement climatique. L’Accord en dénonce et en combat les outils technologiques, commerciaux et politiques : les traités de libre-échange, les droits de propriété intellectuelle sur la vie, les technologies à risques comme les transgéniques, les agrocarburants, la géo-ingénierie, la nanotechnologie et autres similaires qui servent d’instruments de privatisation et « ne font que creuser la crise climatique et augmenter la faim sur la planète ».
A Cochabamba, furent aussi présentes les contradictions internes d’un processus de changement difficile à mettre en œuvre dans un cadre de capitalisme sauvage. Diverses organisations convoquées par la fédération indigène Conseil National d’Ayllus et Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) formèrent de façon indépendante et hors du cadre de la Conférence ce qu’elles appelèrent la « Table nº 18 », pour dénoncer les graves conflits environnementaux provoqués par des projets d’extraction et des mégaprojets d’infrastructure dans le cadre de l’Intégration de l’infrastructure régionale sud-américaine (IIRSA), qui traversent des territoires indigènes et des zones protégées fragiles. Comme résultat de ses débats, la Table a proposé au Gouvernement d’Evo Morales la suspension de toute activité ou de tout projet d’extraction qui affectent les peuples indigènes du pays.
Malgré les contradictions, la Bolivie, depuis son orgueil indigène récupéré, a fait un premier pas fondamental pour que les peuples assument leur rôle face à la crise climatique. Ce pas a laissé une trace. À nous de la suivre et de l’approfondir jusqu’à en faire un chemin.
Raquel Nuñez, WRM, courrier électronique : raquelnu@wrm.org.uy