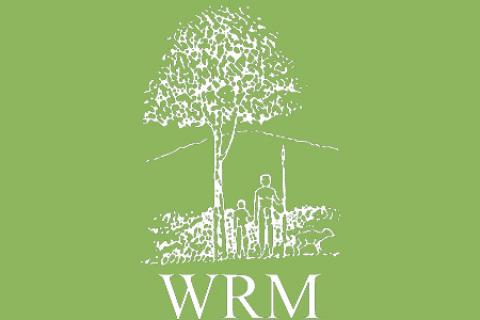À des époques lointaines, le besoin de nos premiers ancêtres de transmettre des paroles et des images se matérialisa sur des murs de pierre, des tablettes d’argile, des planches recouvertes de cire, des peaux d’animaux et d’autres supports. Plus tard, vers l’an 3000 av. J.-C., les Égyptiens commencèrent à écrire sur des rouleaux de papyrus. Les tiges de la plante du même nom étaient coupées en bandes étroites (comme en Chine les lamelles de bambou). L’invention du premier papier véritable en 105 ap. J.-C. est attribuée à Ts’ai Lun, un fonctionnaire chinois.
Articles de bulletin
Les usines de pâte sont destinées à traiter le bois pour l’obtention de la matière première principale de la production de papier : la pulpe ou pâte. Il s’agit en général de grandes usines situées dans les mêmes parages où le bois est récolté, c’est-à-dire à proximité de forêts ou de plantations d’arbres, de manière à faciliter la vidange des grumes et à réduire le coût de leur transport.
La dépossession, la déforestation et la pollution provoquées par l’industrie de la pâte et du papier sont liées à la dynamique d’expansion permanente, de concentration et d’intensité capitalistique qui a caractérisé cette industrie depuis la révolution industrielle. Dans cette dynamique, les tentatives de l’industrie et de ses alliés de réorganiser l’infrastructure politique et physique dans laquelle ils travaillent ont une importance cruciale, et consistent à capter des subsides, à gérer la demande, à centraliser le pouvoir et à esquiver, digérer et contrôler la résistance.
Du fait de leurs énormes dimensions, les usines de pâte doivent simplifier et soumettre à une autorité centrale non seulement le paysage, la diversité biologique et la diversité génétique, mais aussi les systèmes politiques. La taille de ces usines et celle du territoire qu’elles réorganisent autour d’elles les oblige, pour survivre, à constamment obtenir des subsides, à stimuler la demande et, par-dessus tout, à contrôler la résistance, celle du commun des gens comme celle de la nature.
Ashis Nandy, psychologue et critique social indien, a défini un jour le progrès comme une « croissance de la conscience de l’oppression ».
Ce qu’il voulait dire, en partie, c’est que nous avons la chance, grâce aux mouvements féministes, de connaître mieux qu’avant la manière dont les femmes ont été exploitées ; que grâce aux luttes antiracistes, nous sommes plus conscients des nombreuses formes de l’oppression, et que grâce aux longues heures passées par les érudits radicaux dans leurs bibliothèques nous comprenons mieux l’exploitation économique.
Le scénario actuel, où la plupart des pays sont devenus de simples marchés qu’un groupe de plus en plus réduit de puissantes entreprises se partagent tout en entretenant un réseau de liens commerciaux – où elles veulent avoir les coudées franches – a été bâti aussi par l’utilisation du langage et par l’introduction de notions que l’on impose comme des vérités.
La fabrication à partir d’arbres de papier blanc et propre est une sale affaire. Pour faire de la pâte kraft blanchie, le bois est transformé en copeaux, cuit sous pression, lavé et finalement blanchi. Pour la cuisson on utilise des produits chimiques toxiques afin d’éliminer la lignine, une substance gluante qui colle les cellules entre elles pour que les arbres soient forts. Comme la lignine jaunit le papier, tout ce qui en reste doit être éliminé.
La quatrième rencontre du Forum des Nations unies sur les Forêts s’est tenue à Genève. Les délégués gouvernementaux ont passé deux semaines à faire semblant de s’occuper des problèmes qui touchent aux forêts, mais la vérité est que les seules choses dignes de mention ont eu lieu en dehors des salles de réunion officielles (voir ci-dessous la section sur le FNUF).
Les sociétés forestières, les groupes rebelles, les réseaux du crime, plusieurs gouvernements provisoires et le régime de l’ancien président Charles Taylor ont conspiré depuis 1990 pour piller les ressources naturelles du Liberia. Durant cette période, le secteur forestier a été témoin d’une pléthore d’activités illégales. Les sociétés d’exploitation forestière opéraient dans les territoires aux mains des rebelles sans contrôle aucun du Service de développement forestier, et les recettes générées n’ont jamais bénéficié la population du pays.
Lorsque le secrétaire d’État Colin Powell a présenté, en début d’année, le rapport 2003 du ministère des Affaires étrangères des États-Unis sur les droits de l’homme, il espérait sans doute que le scandale des tortures systématiques des prisonniers irakiens par les forces armées de son pays ne verrait jamais le jour. « Le président Bush considère la défense et la promotion des droits de l’homme comme la vocation particulière des États-Unis », avait-il dit.
La réponse du gouvernement vietnamien aux manifestations pacifiques des peuples autochtones, qui ont eu lieu en avril dans les Hauts Plateaux du centre du pays, a été brutale. La police a utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques électriques et des lances à eau pour empêcher les manifestants d’entrer dans Buon Ma Thuot, capitale de la province de Dak Lak. Les policiers étaient aidés par des hommes armés de barres métalliques, de pelles et de machettes. Il y a eu au moins dix morts et des centaines de blessés.
Le 17 avril, plus de 400 soldats des forces spéciales de l’armée équatorienne sont entrés au Détachement Tigre, situé sur la frontière sud-est du Pérou, province de Pastaza, soi-disant pour « capturer, neutraliser et anéantir deux groupes guérilleros » détectés dans la région. Ce territoire appartient à la communauté quichua Yana Yaku, siège de l’Organisation des Peuples autochtones de Pastaza (OPIP), elle aussi occupée le même jour par surprise par 80 militaires, accusée d’être le « foyer de l’appui logistique » de groupes prétendument subversifs.